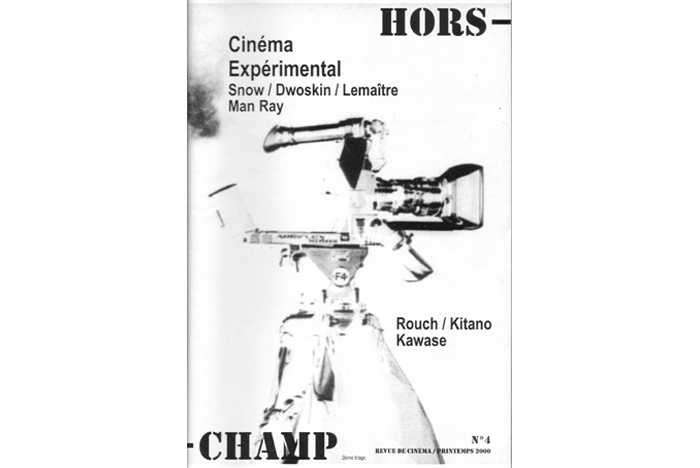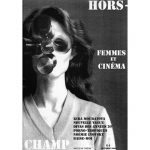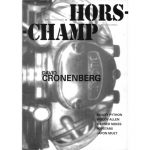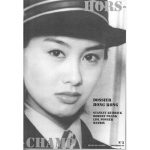ÉDITORIAL
Le cinéma, art expérimental par excellence
En avril, le Centre pour l’image contemporaine et le MAMCO présentent les installations, les photographies et les films de Michael Snow. La Cinémathèque Suisse et le Spoutnik emboîtent le pas à cette manifestation en proposant une rétrospective des films de l’artiste canadien. Cet événement, rendu encore plus exceptionnel par sa venue les 12 et 14 mars à Genève et Lausanne, est à l’origine du dossier que nous consacrons au cinéma expérimental. A l’instar des expérimentateurs des années 20, parmi lesquels figure le rayonnant Man Ray, Michael Snow, artiste polyvalent, à la fois peintre, photographe, musicien, sculpteur, est venu expérimenter sur le terrain du cinéma.
Dans le dossier, le choix d’une présentation chronologique inversée s’est donc fait naturellement, de Michael Snow à Jules Marey en passant par Dwoskin, les lettristes (Lemaître), Man Ray et les expérimentateurs américains des années dix entre autres. L’essentiel étant pour nous de montrer que dans l’expérimentation, on observe une continuité, des années «préhistoriques» à la fin du XXème siècle. Si les intentions ou les motivations diffèrent peut-être entre les expérimentateurs et les époques, leurs recherches s’apparentent, qu’elles soient effectuées sur le medium (pellicule, photogramme, appareil d’enregistrement et de projection cinématographique), sur les procédés narratifs ou la réception de l’oeuvre.
Né de découvertes successives et diverses, dont celle du physiologiste Marey, qui cherchait à décomposer le mouvement, le cinéma apparaît par sa naissance à la fois scientifique et expérimentale comme un instrument de recherche, le plus à même d’interroger les codes de représentation hérités des autres arts. En outre, le cinéma est un instrument scientifique d’expérimentation de la perception puisqu’il permet l’observation des phénomènes dans leur durée.
En effet, au cinéma, le temps est représentable et par conséquent réversible (deux sens de marche; possibilité de les ralentir ou de les accélérer), et c’est en cela que le cinéma peut être considéré comme instrument d’observation de phénomènes autrement imperceptibles, à la manière d’un microscope par exemple.
C’est ainsi que le cinéma nous est apparu comme l’art expérimental par excellence.
Avec la révolution cybernétique, il est permis de se demander dans quelle mesure l’expérimentation telle qu’elle se pratique au cinéma va se poursuivre. Si celle-ci se définit comme privilégiant l’exploration du medium, il va sans dire qu’avec les changements qui s’opèrent à ce niveau dans les nouvelles formes d’expression, l’expérimentation prendra un autre aspect.
C’est avant tout la dimension temporelle qui est fondamentalement altérée. En effet, dans le cas des images de synthèse par exemple, la représentation n’est plus le résultat de l’enregistrement d’une situation, donc d’une temporalité, elle est le fruit de calculs mathématiques répétés à l’infini. La trace, conséquence de l’événement lumineux qui a donné naissance à l’image photographique ou filmique, n’existe plus. La conjonction du réel avec le passé, caractéristique de ces images, disparaît alors. Les notions de virtualité et d’interactivité, qui accompagnent cette nouvelle perception temporelle, donnent au spectateur l’illusion d’avoir prise en temps réel sur l’image qu’il peut modifier à sa guise.
Mais l’abolition de la trace a aussi des répercussions sur le rapport que la représentation entretient avec la réalité. A l’inverse du cinéma, dont c’était la vocation première, l’image numérique, née d’une abstraction, n’a pas pour but de rendre compte d’une réalité existante. Le cinéma, qu’il soit tourné sur lui-même ou sur le monde reste un instrument d’investigation du réel. Il est aujourd’hui concurrencé par un système de représentation qui se suffit à lui-même et qui n’entretient plus de rapport indiciel avec la réalité qu’il s’efforce pourtant d’imiter.
L’image de synthèse n’est qu’un exemple des changements paradigmatiques introduits par les nouvelles technologies. Reste à savoir maintenant si celles-ci offriront aux artistes un terrain d’expérimentation aussi fécond que le cinéma.
La rédaction
Sommaire
2 Éditorial
CINÉASTES
4 Jean Rouch et la figure de l’aller-retour
Analyse – Alain Boillat
9 Du bon usage des traces : Ni tstusumarete de Naomi Kawase
Analyse – Marie-Aline Hornung
DOSSIER CINÉMA EXPÉRIMENTAL
14 Pour une définition
Antoine Cattin, Elena Hill, Marie-Aline Hornung
MICHAEL SNOW
22 Envol immédiat
Laure Bergala
24 Vue vue – « installation »
Stefani de Loppinot
25 Deux temps trois mouvements
François Bovier
STEVEN DWOSKIN
32 Bouclées!
Laurent Guido
38 La caméra au rythme des corps Lire l’article
Laurent Guido
MONOGRAPHIE
42 Maurice Lemaître ou l’«a-cinéma »
Maasa Seki
HISTORIQUE
46 « Dada-Cinéma » : la réception du film comme catalysateur d’expérience(s)
Mireille Berton
48 Man Ray, cinéaste-expérimentateur
Mireille Berton
54 Les rebelles des années vingt
Pierre-Emmanuel Jaques
FILM
58 Hana-bi, violente solitude
Analyse – Vlad Tanasescu
ETAT DES LIEUX
64 Association BRAQUAGE
Compte rendu – Sébastien Ronceray
65 Trésors insoupçonnés à la Cinémathèque suisse
Compte rendu – Anne Wÿrsch